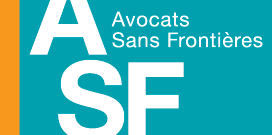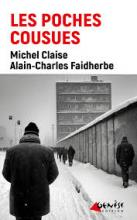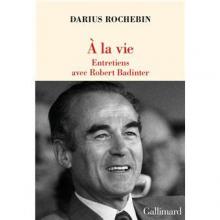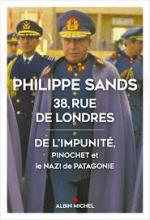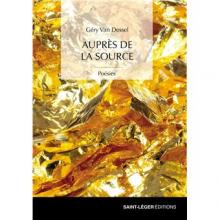Les poches cousues, par Michel Claise et Alain-Charles Faidherbe
Posté le 22/01/2026Les poches cousues, par Michel Claise et Alain-Charles Faidherbe, Paris et Bruxelles, Genèse éditions, 2025, 240 pages, 14,50 euros.
- Monsieur le président, nous nous sommes réunis pour vous affirmer notre total soutien. Mais aussi pour vous convaincre de poursuivre votre combat, auquel nous nous associons. Vous ne pourrez le mener seul. Il faut que vous soyez assisté par au moins deux confrères qui interviendront dans toute procédure contre vous.
Il doit être rare qu’un barreau se réunisse en assemblée générale pour affirmer ainsi un soutien total à un président de tribunal.
Mais dans ce pays des Balkans, que les auteurs ne citeront pas, sauf à dire qu’il est candidat à l’Union européenne et à l’espace Schengen, c’est arrivé.
Vous connaissez bien sûr Michel Claise, ancien juge d’instruction à Bruxelles et auteur de nombreux ouvrages palpitants déjà recensés dans cette rubrique.
Celui-ci est particulier. Il est écrit à quatre mains. Il nous est cependant précisé que seul Michel Claise l’a rédigé mais en mettant en prose l’histoire que lui a racontée Alain-Charles Faidherbe. Et cette histoire, c’est la sienne, sous la seule réserve que son nom d’auteur est un « nom de protection », car il est toujours sous la menace des mafias qu’il a combattues toute sa vie.